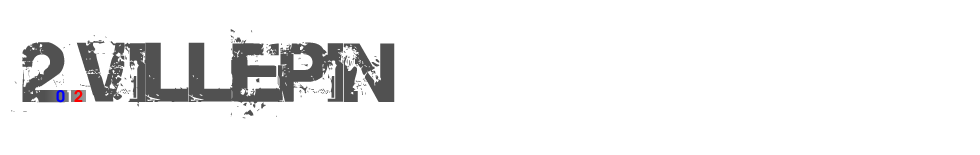Le mécanisme dit de TVA sociale consiste à basculer une partie du financement de la Sécurité sociale des entreprises vers les ménages, via une baisse des cotisations patronales et une hausse simultanée de la taxe sur la valeur ajoutée.
Pour ses promoteurs, au rang desquels se trouve le président Nicolas Sarkozy et, dans une moindre mesure, le premier ministre François Fillon, ce transfert de charges permettra d’alléger le coût du travail en France, de taxer davantage les produits importés, notamment ceux en provenance des pays à bas coûts, tout en favorisant les exportations. Aux yeux de ses détracteurs, à gauche notamment, ce système entraînera surtout une augmentation des prix qui pénalisera les consommateurs, en particulier les plus modestes.
Le mécanisme
Dans son livre-programme Ensemble, M. Sarkozy estimait « venu » le temps de l’expérimentation, voyant dans la TVA sociale « un moyen pour lutter contre les délocalisations, pour créer de l’emploi, pour faire augmenter le pouvoir d’achat ». « L’assiette de la TVA étant plus large que celle des cotisations sociales, écrivait-il, environ un tiers de la baisse des cotisations pourrait être réalloué à l’augmentation du pouvoir d’achat ». Il ajoutait que le « report de charges sur la TVA devra s’effectuer progressivement, par le biais de franchises de charges sur tous les salaires » et proposait que les clauses d’indexation des salaires sur les prix, dont il veut abroger l’interdiction, « puissent être négociées dans chaque branche, dans chaque entreprise, en fonction de la situation économique ».
La taxe sur la valeur ajoutée est actuellement de 19,6 % en France même si, comme dans plusieurs autres pays, certains secteurs bénéficient de taux réduits, à 5,5 % (produits agricoles, produits culturels ou travaux de rénovation des logements) ou 2,1 % (médicaments remboursés par la Sécurité sociale). En 2006, cet impôt a rapporté environ 126 milliards d’euros en 2006 à l’Etat, soit presque la moitié des recettes fiscales.
Les effets
François Fillon, qui a ouvert le débat sur ce sujet, n’a pas encore évoqué de chiffres, se contentant d’affirmer qu’ »il ne s’agit pas d’alourdir les impôts » ni « d’augmenter la TVA pour boucher les trous ».
Dans l’édition du 12 juin des Echos, Jean Arthuis, ancien ministre de l’économie du gouvernement Juppé et auteur d’un rapport prônant l’instauration de la TVA sociale, estime que l’augmentation du taux d’un point, à 20,6 %, rapporterait « 7 milliards d’euros par an, sur les produits soumis au taux normal et 2 milliards d’euros sur les produits actuellement taxés au taux réduit de 5,5% ». Ce supplément de recettes devrait être supérieur à la baisse attendue des charges pour renflouer les caisses de la Sécurité sociale.
M. Arthuis assure que le gouvernement pourrait pousser cette hausse « jusqu’à cinq points de TVA supplémentaires » et qu’elle devrait être générale et non pas cantonnée à un seul secteur d’activité. Malgré cette forte hausse, « les prix des produits fabriqués en France n’augmenteront pas », affirme-t-il, partant du principe que les entreprises répercuteront intégralement la baisse de leurs cotisations sur les prix de leurs produits.
Or, c’est sur cet effet économique que les analyses divergent. Selon Thomas Piketty, directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) et proche de Ségolène Royal, une hausse de la TVA provoque immanquablement une hausse des prix. « A chaque fois qu’un gouvernement a augmenté la TVA, cette hausse s’est répercutée sur les prix. Pas à 100 %, c’est vrai, mais en moyenne à 60 % ou 70 %, selon les secteurs », explique-t-il.
Les applications à l’étranger
Ce dispositif a été mis en place en Allemagne par le gouvernement d’Angela Merkel, qui a fait passer le taux principal de la TVA de 16 % à 19 % au 1er janvier 2007. Un tiers des recettes supplémentaires a été affecté à un allègement des cotisations patronales et le restant aux finances de l’Etat fédéral. En revanche, le taux réduit de 7 %, appliqué à presque tous les produits alimentaires, aux transports en commun, aux livres ou encore aux journaux, n’a pas varié. Les loyers ou les prestations de santé sont, eux, exemptés de TVA.
S’il est encore trop tôt pour juger des effets réels de cette mesure outre-Rhin, les observateurs n’ont constaté aucune hausse sensible de l’inflation. Mais cet effet peut également être expliqué par la haute rentabilité des entreprises allemandes, qui auraient consenti à sacrifier une partie de leur marge pour empêcher une envolée des prix. Or, la situation est bien différente en France, comme l’explique Mathieu Kaiser, analyste de BNP Paribas, cité par un quotidien économique : « Les entreprises françaises ont une rentabilité plus faible et elles pourraient être tentées de restaurer leur marge en répercutant la hausse de la TVA sur leurs prix finaux, sans augmenter les salaires ».
Auparavant, le Danemark avait adopté ce système dès 1987. En supprimant les cotisations sociales des employeurs, le pays scandinave avait opté pour une augmentation de 3 points de son taux de TVA, porté à 25 %. Près de vingt ans après, les économistes peuvent dire avec certitude que cette mesure n’aura eu aucun effet particulier sur l’inflation, certains estimant même qu’elle a contribué à baisser le taux de chômage (4,8 % en 2006), créer de la croissance ainsi qu’une balance commerciale positive.
Source: Le Monde